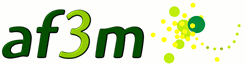Le Pr Agnès Buzyn a été désigné par le Président de la République pour présider le Collège de la HAS à compter du 7 mars 2016. Elle remplace le Pr Jean-Luc Harousseau pour la fin de son mandat jusqu’au 31 janvier 2017 et sollicitera un nouveau mandat.
Agnès Buzyn, l’humanité en médecine - article de Pierre Bienvault - LaCroix, 20/05/16.

Après avoir dirigé l’Institut national du cancer, cette hématologue de 53 ans a pris en mars la tête de la Haute Autorité de santé . Un nouveau défi pour une femme de conviction qui a passé la plus grande partie de sa carrière à l’hôpital. Un univers dont elle raconte l’humanité au service des malades. Et la violence des querelles internes entre mandarins.
Est-ce là son péché mignon ? En tout cas, la première chose que l’on remarque en entrant dans le bureau d’Agnès Buzyn, c’est un plateau de friandises posé sur sa table de réunion. Petits bonbons acidulés et chocolats gélifiés à la guimauve. Des friandises de cour de récréation sans doute guère recommandées par les experts en nutrition santé. "Je n’ai que des bonbons régressifs à vous proposer", sourit la présidente du collège de la Haute Autorité de santé (HAS).
Une chose est sûre en tout cas : l’agenda d’Agnès Buzyn ne doit pas lui laisser beaucoup de temps pour se laisser aller à la gourmandise. Avec ses 400 employés et ses 2 800 experts, la HAS est une grosse "machine" qui joue un rôle clé dans le monde de la santé. Mise en place en 2005, cette instance est chargée d’évaluer les médicaments remboursés par la Sécurité sociale. La HAS élabore aussi des recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels de santé et délivre des certifications aux hôpitaux.
Histoire de famille : Agnès Buzyn a pris ses fonctions début mars après avoir dirigé pendant cinq ans l’Institut national du cancer (INCa). Et elle entend garder à la HAS la même ligne de conduite : toujours agir en médecin et dans l’intérêt des malades. "À l’INCa, j’ai eu des décisions difficiles à prendre. Et à chaque fois, je me suis dit la même chose : est-ce que cela sera ou non utile aux patients ? Une fois cela en tête, la décision est plus facile", constate Agnès Buzyn.
Toujours agir en médecin. Impossible de faire autrement pour cette femme de 53 ans à la vocation ancrée dans l’histoire familiale. Un père et un oncle chirurgien, une mère psychologue-psychanalyste, un autre oncle réanimateur. "Il y avait un atavisme familial auquel il était difficile d’échapper… ", confie Agnès Buzyn qui, jeune adolescente, rêvait pourtant plus du 7e art que d’Hippocrate. "En principe, le jeudi après-midi, mon père devait m’emmener au cinéma", raconte-t-elle. "Mais il arrivait souvent qu’il soit mobilisé pour une urgence à la clinique. Alors il m’emmenait avec lui au bloc."
Comme son père, l’étudiante brillante a fait médecine pour devenir chirurgienne. Mais à l’internat, elle a opté pour l’hématologie et les maladies du sang, notamment les leucémies. "J’ai fait ce choix car c’est une spécialité très technique mais aussi très humaine. En chirurgie, on opère puis on ne voit plus le patient. Moi, j’avais envie de soigner les gens en les accompagnant dans la durée", confie Agnès Buzyn, en le reconnaissant volontiers : à l’hôpital, les consultations avec ses patients étaient souvent très longues. Le temps de parler de la maladie, du traitement, des effets secondaires.
Près des patients : Et puis de tout le reste. De tout ce qui se passe quand le patient ressort de l’hôpital. Le travail, la maison, les factures, le conjoint, les enfants. Toute cette vie qui, du jour au lendemain, n’est plus la même quand survient une maladie grave. "Le rôle d’un médecin n’est pas juste de guérir son malade. C’est aussi de savoir si, par exemple, il a perdu son emploi ou s’il peut encore payer son loyer. Une maladie grave, c’est un accident dans un parcours de vie. Et la mission du soignant, c’est de remettre le patient sur le chemin de son existence. Sans céder à la tentation de se réfugier derrière le seul acte technique".
Agnès Buzyn n’a visiblement jamais oublié ses patients. Et c’est avec bonheur qu’elle parle de tous ceux qui, guéris, continuent de lui envoyer des fleurs pour son anniversaire. "Parfois de l’autre bout du monde." Mais dans sa mémoire, il y a aussi tous les patients qu’elle n’a pas pu sauver. "Je n’ai jamais réussi à me blinder face à cela", avoue-t-elle, en reconnaissant la difficulté de savoir, parfois, où fixer la limite dans la relation médecin-malade. "Une fois, je suis allée aux obsèques d’un de mes jeunes patients, à la demande de sa mère. Ce fut un moment insoutenable et une erreur de ma part."
Si elle a réussi à tenir, durant toutes ses années, c’est d’abord grâce à une vie personnelle épanouie. "À mes trois enfants et mon mari, médecin dans le sida. Ce qui m’a beaucoup aidé, c’est aussi de m’investir dans la recherche. Quand vous soignez des maladies graves, c’est important de se battre pour trouver de nouveaux traitements."
Machisme ordinaire: En poste à Necker à Paris, Agnès Buzyn a tout connu de la réalité de la médecine hospitalière. Et de son univers très largement masculin dans les strates du pouvoir. Le machisme ordinaire de collègues étonnés qu’une femme puisse vouloir devenir professeur. "L’un d’eux m’a dit, en faisant référence à mon mari, qu’il n’y avait pas besoin d’avoir deux salaires de professeurs dans un même foyer", raconte Agnès Buzyn. "Ce machisme existe. Mais ce qui prime, c’est surtout quelque chose qui se joue dans l’inconscient de ces hommes de pouvoir. Leur incapacité totale à penser qu’il est possible de nommer une femme à un poste de responsabilités. Ils ne se projettent que dans le masculin."
Les coulisses de l’hôpital. Et tous les paradoxes de cette institution dédiée au soin et au bien-être, parfois si inhumaine et si violente dans ses querelles internes, ses défenses de territoire, ses batailles d’ego aussi féroces que dérisoires.
De 2004 à 2008, Agnès Buzyn a vécu très douloureusement une "mise au placard" dans un service où elle était adjointe. Et dont le chef l’a subitement écartée de toutes les réunions. "C’est difficile de savoir pourquoi cela arrive. Sur le coup, vous avez le sentiment de vivre un truc de dingues. Vous avez travaillé toute votre vie, vous êtes reconnue et puis, un jour, on estime que vous n’êtes plus rien. Dès que je disais blanc, mon supérieur disait noir. Y compris parfois au sujet des patients. À tel point qu’à un moment, j’ai fini par dire l’inverse de ce que je pensais, simplement pour que la décision aille dans mon sens."
Agnès Buzyn ne raconte pas cela pour s’ériger en victime. Juste pour témoigner d’une réalité souvent vécue dans la solitude et le silence. Pour dire que les brimades, les humiliations, le harcèlement moral peuvent détruire une existence. "C’est très violent. Et sans mes enfants, peut-être que j’aurais songé au suicide."
« S’engager au service du plus grand nombre »
Des mots aussi pour raconter ce fonctionnement si particulier de l’hôpital. Ce monde en vase clos où règne la logique de la cooptation et du pouvoir absolu de certains médecins qui n’ont de compte à rendre à personne. "Il y a très peu de mobilité. C’est très difficile pour un professeur d’être muté sur un autre poste. À un moment, j’ai demandé de l’aide à la direction de l’hôpital puis à celle de l’AP-HP (1). Juste pour leur demander de changer d’hôpital. Mais rien n’a bougé. À chaque fois, on disait que c’était compliqué."
Finalement, Agnès Buzyn n’a pu s’en sortir qu’en prenant, en 2008, la tête de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). "Une opportunité formidable car j’avais depuis longtemps envie de m’engager au service du plus grand nombre, de ne plus travailler uniquement pour mes malades", dit-elle.
À ce poste, Agnès Buzyn a dû gérer la crise ouverte après l’accident de Fukushima au Japon en mars 2011 et le débat sur la sécurité des centrales nucléaires. Un exercice réussi qui lui a valu sa nomination, deux mois plus tard, à la tête de l’INCa où elle a pu élaborer le troisième plan cancer, annoncé en 2014 avec un objectif majeur : continuer à lutter contre les inégalités des Français face à la maladie. "C’est un combat essentiel, dit-elle. Car il n’y a rien de plus insupportable pour une personne, qui souffre d’une maladie grave, que de penser qu’elle a moins de chance de s’en sortir que son voisin."
En savoir plus ... L'article de La Croix